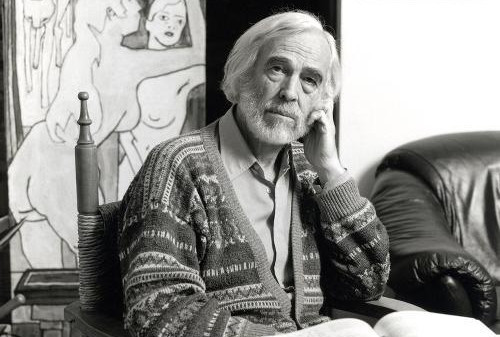Livre auto-édité de Michel Lobrot, 2006
Morceaux choisis
Difficulté de dire ce que je ressens face à cette femme, que je vois nue chaque semaine dans un hammam que je fréquente depuis des années, et que je désire… Qui me plaît… Dont j’admire la beauté… Il est vrai qu’elle n’a pas semblé comprendre ce que je demandais quand je lui ai fait une proposition, comme si je parlais une langue étrangère. Elle n’a rien répondu et j’ai depuis, avec elle, toujours le même rapport, fait de tendresse, de proximité et de connivence… Mais ce n’est pas là le problème… Le problème est de rendre ce que je peux ressentir… C’est presque impossible… Son corps est comme une construction, où chaque élément est à sa place, mais vit de sa vie propre : ses seins, ses fesses, son ventre, son dos sont tous indépendants, comme des personnages… Il y a à la fois une harmonie et une mouvance… Comme une présence de chaque élément à soi… Comme une faiblesse aussi de chacun de ces éléments… Ses seins, par exemple, sont bien faits mais légèrement tombants, désarmés… Tout en elle est comme cela… Rien n’est mécanique… Sentiment que la parole est impuissante à exprimer cela…
(…)
Je vais me retrouver la semaine prochaine seul, puisque Nicole va faire un voyage en Grèce. Cela à la fois me réjouit et me fait peur. L’idée de cette solitude fait surgir en moi des désirs d’activités que je ne fais pas quand je suis avec quelqu’un : peinture, musées, spectacles, écriture intensive, recherches, porno, etc. Mais je sais qu’à certains moments, je vais flipper, n’étant pas distrait par une parole quotidienne ou par une parole intense, étant face à moi-même, comme on dit… Mais je ne sais pas trop ce que cela veut dire. Cela fait partie de ces formules qu’on emploie tout le temps, mais qui sont creuses, ou peut-être trop pleines. Justement, je ne serai pas face à moi-même, comme je le suis quand Nicole est là et qu’elle me titille. Je serai plutôt dans une espèce de vide, au moins quand je ne serai pas pris par des occupations spéciales. Pas capable, peut-être, de rester sans rien faire, dans une position de légume. Retrouver mon côté végétal, végétatif.
(…)
Intéressante cette participation à un débat sur la sexualité, menée selon mes principes pédagogiques par quelqu’un qui y croit et qui s’en tire bien. Je m’imaginais qu’il y allait avoir foule. La sexualité attire les foules… C’est le contraire. Elle leur fait peur. Il n’y avait pas un seul jeune et les gens qui arrivaient n’avaient plus, de toute évidence, aucune sexualité. Les jeunes ne s’intéressent pas à cela. A quoi s’intéressent-ils ? La génération des années 80 a subi une érosion effroyable, cela est connu… Dès le départ du débat, les choses étaient claires. Les thèmes proposés étaient du genre : qu’est ce que la sexualité ? Le thème retenu était tout autant significatif : peut-on être aussi épanoui avec que sans la sexualité ? Je me suis, comme toujours jeté dans la bagarre, m’impliquant fortement et entraînant la conviction. Certaines femmes ont dit être troublées par mon témoignage. Je suis parti de là déçu, mécontent, solitaire. Quand vais-je être indifférent face à cet océan de médiocrité ?
(…)
Quand une nouvelle femme entre dans ma vie, comme c’est le cas actuellement avec Théresa, elle s’introduit doucement dans mon paysage intérieur, sans faire de bruit mais efficacement et se met à une certaine place, en accord avec les autres femmes. Elle n’élimine pas celles-ci. Plus exactement, je n’ai pas de raison de les éliminer. De toute façon, elles ne se gênent pas, car elles ne sont pas à la même place. Elles ne m’apportent pas la même chose. On dira que c’est une façon bien égocentrique de voir les choses. Je suis d’accord. Mais ne vaut-il pas mieux cela que de procéder à des suppressions violentes et destructives, qui ne sont finalement que des mutilations ?
(…)
Observer ma propre pensée en train de se faire m’intéresse, comme observer un insecte. Les déroulements et enroulements de la réflexion sont fascinants. C’est tellement obscur, tellement inattendu.
Justement ce matin, en relisant le journal et le roman écrits par une de mes patientes, quand elle avait entre seize et vingt ans, me procure une véritable illumination.
J’étais obsédé, depuis une vingtaine d’années, par le problème de l’influence des parents et de l’entourage en général sur le développement du jeune et j’étais guidé dans cette recherche par une expérimentation faite par un américain dans les années 70. Cet américain avait sélectionné deux populations de femmes : l’une traditionnelle, conformiste, attachée aux normes ; l’autre, progressiste, ouverte, novatrice. Il avait remarqué que ce qui séparait les deux populations était le fait que les femmes du premier groupe considéraient leur mère comme réussie, forte, structurée et celles du second groupe comme faible, incertaine, fragile. C’était la seule différence. Les idées des mères sur la vie et la conduite dans la vie ne jouaient pratiquement aucun rôle. Par exemple, une mère de type traditionnel, qui avait un schéma caractériel à base de faiblesse et d’incertitude, avait généralement une fille de style moderne, et, inversement, une mère moderniste et libérale, avait une fille traditionnelle et rigide, si elle était elle-même forte et structurée.
Je me mis à gamberger à partir de cela. Mon idée était que les filles traditionnelles devaient admirer leur mère, tandis que les filles modernistes ne devaient pas les admirer. J’ai multiplié les questionnaire et enquêtes, entre 1980 et 2000, pour tester cette hypothèse, sans obtenir vraiment de résultats. Ceux-ci étaient plutôt en sens inverse. J’étais plutôt découragé.
Et voilà que, ce matin, en lisant ce journal et ce roman, je m’aperçois que l’auteur, qui est maintenant adulte et qui souffre de problèmes énormes au niveau de la sexualité, décrit la mère de l’héroïne de son roman, comme ultra-possessive, totalement centrée sur sa fille, qui devient naturellement dépendante d’elle au plus haut point. Et d’ailleurs le roman entier se résume dans une quête de la fille pour retrouver son père et rentrer ainsi dans la normalité. Elle réussit à le retrouver mais, bien loin que cela lui procure un équilibre, cela la déséquilibre complètement. Elle l’exprime dans une espèce de post-face. « Elle (l’héroïne) opère une lente désescalade, dit-elle, elle s’empêtre dans ses propres sentiments et ne parvient plus à se comprendre elle-même. Tout bascule, tout s’effondre, tout va mal dans la vie de Sonia, jusqu’à la fin où c’est le chaos complet ».
Comme toujours dans ce cas là, je fais le lien de cette observation avec une autre idée que j’ai par ailleurs et qui est nouvelle pour moi. Cette idée, issue de réflexions sur les processus institutionnels, c’est que, dans un certain type de contexte, les pressions sur l’individu ne sont plus de type coercitif et contraignant, mais du type protecteur, sécurisant, donc acceptés et voulus par la personne (schéma du contrat social). Le contexte est alors évidemment vécu comme fort, assuré, résistant, comme celui qui est créé par les mères de filles traditionnelles.
Cela s’applique à l’éducation. Les parents peuvent naturellement imposer leur loi par la contrainte et la menace, comme c’est généralement le cas, mais ils peuvent aussi pratiquer une espèce de surprotection et de captation, qui emprisonne beaucoup plus sûrement le jeune. Celui-ci perd sa liberté et se voit obligé de pratiquer une auto-répression, qui le coupe de ses sources de développement.
Dans la foulée, je me précipite sur un livre que j’ai dans ma bibliothèque, qui s’appelle Psychothérapies familiales, par I. Boszormenyi-Nagy, dans lequel il y a un premier chapitre, où l’on montre que, d’après de nombreuses recherches, les jeunes schizophrènes sont généralement issus de familles surprotectrices et captatives. Affaire à suivre !
(…)
Le cerveau est une partie importante de l’être humain. Aussi est-on tenté d’en faire l’essentiel de l’être humain. Celui-ci serait un corps transportant un cerveau. Drôle de conception, qui est pourtant de plus en plus celle de nos modernes psychologues, par exemple celle des collaborateurs de la revue Cerveau et Psycho, à laquelle je viens de m’abonner, qui est une excellente revue, mais où malheureusement chaque article se croit obligé de faire référence à et d’analyser les correspondances encéphaliques des phénomènes psychiques considérés. Cela est évidemment très sécurisant. On a l’impression d’étudier une machine, dont on appréhende clairement les composantes, dont on peut démonter les rouages et expliquer les articulations.
Mais ceci est une tromperie. Il est clair que le psychisme n’est pas une machine. L’illusion qu’on entretient est du même ordre que celle qui consisterait à expliquer une conversation au téléphone par les variations des ondes acoustiques enregistrables, ou une émission à la Télévision par les modifications des ondes hertziennes qui produisent l’image. Les phénomènes mécaniques et électriques sont nécessaires mais non explicatifs. La construction que les phénomènes mécaniques et électriques véhiculent est élaborée ailleurs. Elle n’est certes pas élaborée dans une âme immatérielle mais dans un organisme complet qui se comporte alors comme un instrument de musique, dont on ferait vibrer de multiples cordes.
Le cerveau ne véhicule pas la pensée, pas plus qu’il ne véhicule les sentiments ou les sensations. Il est seulement un support nécessaire. Il faut entendre par là qu’une pensée, une sensation, une impulsion ne peuvent exister si elles ne sont pas relayées et traduites en impulsions électriques indifférenciées, qui sont concomitantes, simultanées. Ceci est difficile à comprendre, mais fait partie de la vie même. Celle-ci ne consiste pas dans un jeu d’éléments matériels qui se déclenchent en série, par poussées, chocs, mouvements continués (en inertie) ou attractions newtoniennes et quantiques, mais dans une mise en acte, une activation d’éléments liés dans un schéma survolant, pas nécessairement reliés spatialement ou en contact immédiat. La vie n’utilise pas l’espace comme la nature matérielle, dans la continuité et la transitivité.
(…)
On peut comprendre, par ce que je viens de dire, que j’ai eu ce problème la nuit dernière. Je pense beaucoup à cette amie avec laquelle ce problème n’existait pas, parce qu’elle était toujours prête et toujours active. Une vraie bombe, toujours prête à exploser ! Mais cela ne faisait pas d’elle la femme de mes rêves, même si elle réalisait un rêve. Ce n’est pas la seule chose qu’on demande à une femme. Je demande autre chose à la femme avec laquelle j’étais cette nuit !
(…)
A côté de la plaque. Ils sont a côté de la plaque. Cela ne les empêche pas d’être opposés et ennemis. Il y a d’un côté les soi-disant novateurs ou démocrates, comme ce monsieur Thélot, qui veulent le collège unique, que tous les enfant soient longtemps mélangés, pour acquérir ce qu’ils appellent les acquis fondamentaux, le socle commun lire-écrire-compter, l’anglais, l’ordinateur, et, de l’autre, l’inévitable Finkelkraut, que j’appelle inévitable parce que son infatuation, son conservatisme recuit le rendent insupportable. Lui, il veut, avec les conservateurs, le vieux système des enfants sériés, distribués, classés, qui travaillent chacun de leur côté à se préparer à assumer leur rôles sociaux respectifs, bien hiérarchisés… Leur aveuglement à la réalité, aux uns et aux autres, est terrifiant. Quelque soit le programme auquel on soumet l’enfant, pour son bien, que ce soit un programme de mélange soi-disant démocratique ou de forcing pédagogique pour en faire un chef, le résultat est le même : nul. On le sait maintenant fort bien. La nullité des savoirs et des connaissances, y compris dans la lecture et le calcul, qui a été mesurée en bonne et due forme, rejoint la hargne, la fermeture, l’incompétence sociale de ces cadres qui nous gouvernent. Tant qu’on n’écoute pas l’enfant, tant qu’il ne construit pas lui-même sa vie et son avenir, on en fait un petit malheureux, voué à la misère de l’oppression sociale ou au vide de la domination.
(…)
Il y a un paradoxe de l’amour. Si tu t’éloignes de moi, si tu veux ta liberté, si tu t’autonomises, alors je ne t’aime plus, alors que précisément je prétends t’aimer trop pour accepter que tu t’éloignes. Ce n’est pas désir de vengeance, comme on pourrait le croire, ou désir de punir, mais beaucoup plus profondément, ce qu’on pourrait appeler l’économie de l’attrait. Si je t’aime essentiellement parce que je veux quelqu’un qui soit à côté de moi et qui me tienne compagnie, comme un dérivatif et une occupation, alors il est normal que l’éloignement provoque ce genre de réaction. A vrai dire, il ne s’agit pas exactement d’une réaction, mais plutôt d’une diffusion de la frustration. Le psychisme n’arrête pas de diffuser. On envisage brusquement toutes les conséquences de cet éloignement, même si elles ne sont pas réelles ou si elles ne sont qu’anticipées, et on est horrifié. Et on rêve de la séparation, qui va vous mettre dans un état encore pire, mais avec l’espoir de trouver enfin le bon chien fidèle, qui restera tranquillement au pied de son maître. Rassurez-vous : ça existe.
(…)
Ma totale absence de sexualité de 0 à 20 ans. J’ai beaucoup réfléchi là-dessus. J’ai même participé à un groupe où on travaillait sur un manuscrit de moi, écrit à l’âge de trente ans, où je parle de ce phénomène. Maintenant, je crois comprendre. Cela me paraît même très simple.
La cause n’en est pas, comme je le croyais, les interdits venant de mes parents concernant la sexualité, car il n’y en avait pas, mais du mépris qu’ils avaient pour cette conduite. Ce mépris passait naturellement parfois à travers la parole, comme dans cet épisode, que j’ai cent fois raconté, où ma mère me confronte avec des images pornographiques que j’avais réunies avec bonheur et une émotion énorme, chez mon oncle, et où elle me disait : ce n’est pas toi, ce ne peut pas être toi qui as fait cela, une chose pareille… Et, naturellement, je dis que ce n’était pas moi qui avais fait cela.
La plupart du temps, il n’y a même pas besoin de cela. Tout chez mes parents, tout, disait qu’ils n’aimaient pas le plaisir, je veux dire le plaisir des sens, pas celui de l’esprit ou du cœur. Leur cadre de vie était triste, presque lugubre. Je ne peux pas me souvenir de mon père ou de ma mère en train de rire. Je ne les revois pas riant, en train de rire, éclatant de rire. Il n’était jamais fait la moindre allusion à la sexualité, comme une chose qui n’existait pas, qu’on ne trouvait pas dans l’univers…
On me dira que normalement, d’après mes théories, je n’aurais pas dû m’en sortir, tant l’atteinte était profonde. Cela est vrai… Si je m’en suis sorti, c’est parce qu’à vingt ans, étant chez les dominicains, j’ai compris, à travers une nouvelle interprétation des Evangiles, liée au mouvement intellectuel des années de la guerre, la valeur sur-éminente de l’amour. Ce mot magique a tout bouleversé en moi, m’a retourné littéralement. Amour pour moi voulait dire aussi amour sexuel. C’était l’amour total, où le corps naturellement a sa place et sert de ciment. C’était l’amour de madame Guyon. Je m’y suis mis et ça a marché…
(…)
Il ne mange que ce qu’il a décidé, dit la mère en parlant de l’enfant, qui est là présent, qui a une dizaine d’années et qui a en effet de gros problèmes par rapport à la nourriture. Cela veut dire implicitement que l’enfant devrait s’en remettre à sa mère pour savoir ce qu’il doit manger, s’il est un bon enfant, qui ne décide pas lui-même de cette chose éminemment personnelle, qui est la nourriture qu’il désire ou dont il a besoin. On touche là directement, pour ainsi dire expérimentalement la manipulation psychologique ou ce que j’ai appelé antérieurement la dépréciation. Le sujet est annulé pour ainsi dire, dans sa capacité à décider ce qui est bon pour lui, ce qui lui convient et lui fait plaisir ; il ne peut pas avoir une opinion là-dessus ; cela lui est impossible. Et l’enfant ne peut que croire sa mère, qui, elle, sait, qui a le savoir… Le fait qu’elle dise, en l’occurrence, que l’enfant ne mange que ce qu’il a décidé (de manger) prouve que cet enfant résiste, tient tête, entend affirmer ses désirs. Et pourtant il ne mange plus, vire à l’anorexie. Pourquoi ? On peut faire l’hypothèse que la guerre qu’il est obligé de mener contre sa mère à chaque repas l’épuise, lui enlève le goût de manger. A l’étape suivante, il capitulera, cessera complètement de manger et connaîtra des états encore pires… Vouloir et savoir manger exigent toute une recherche, toute une expérimentation, qu’on ne peut faire que si on est assez libre de ses mouvements, assez sûr de soi, ce qui devient impossible dans un contexte de harcèlement incessant. On tombe dans ce que Pérez et Mugny appellent la paralysie socio-cognitive, état de celui qui se range et obéit et qui, de ce fait, n’a plus la force et l’audace d’expérimenter, de vouloir… Cela explique, très probablement, la quantité d’enfants qui adorent les Mac Do, alors que leurs parents sont des fins gourmets, des gastronomes éprouvés. On leur a trop dit ce qu’ils devaient manger ceci ou cela, qui était bon pour eux…
(…)
Comme c’est ton jeune ami qui a fait cela, dit K., je peux comprendre et accepter. Ce qu’a fait mon jeune ami, on le sait, est d’avoir permis à des minettes de se faire de l’argent de poche en se prostituant, chose qui peut apparaître terrible, mais qui a naturellement une logique, dont j’ai déjà essayé de parler… Cependant, dit K., s’il s’attaquait à ma fille (qui a actuellement 12 ans), je le massacrerais. C’est le mot qu’elle emploie. Mot terrible, mais tellement évocateur… Deux choses peuvent être remarquées à ce propos. La première, c’est le changement d’attitude quand on passe d’un individu connu, d’une manière plus ou moins intime, à un individu inconnu. Le deuxième est automatiquement un salaud. Cela rejoint mon idée que la connaissance empathique de l’autre réduit la peur qu’il engendre, malgré le fait, que j’ai déjà signalé, qu’il peut produire un choc plus intense. On sait comment il fonctionne et cela rassure…La deuxième chose est le fait que la fille en question, quand elle aura quatorze ou quinze ans, ne sera pas autorisée à faire de son corps l’usage qu’elle voudra, si celui-ci n’est pas approuvé par sa mère et par la société. Son corps ne lui appartient pas, comme dirait Victor Margueritte. On peut tolérer qu’une fille se marie avec l’espoir d’être soutenue économiquement par un mari aisé, ce qui peut équivaloir à de la prostitution, mais non qu’elle ait une relation passagère, beaucoup moins impliquée, avec un homme qui la paie…Toujours cette assimilation d’une réalité à une de ses formes particulières, pour peu que cette forme fasse peur ou horreur… Bien sûr que la prostitution peut s’accompagner de violence et de contrainte, mais pourquoi la réduire à cela ? Henri Miller avait raison de dire que la prostitution est un métier honorable. Après tout, la libido fait ce qu’elle veut et va où elle veut. Ce n’est pas monsieur Sarkosy qui va nous dire ce qu’il faut en faire…
(…)
C’est fou de passer du temps à écrire… A quoi ça sert ? Mais ça ne sert à rien… Pourquoi veux-tu que ça serve à quelque chose ? – Parce que tout doit servir à quelque chose – Non, je ne suis pas d’accord. Rien ne sert à rien… Qu’est ce que c’est que cette littérature de gens de service, comme disait Léautaud ? Je ne suis pas quelqu’un qui sert quelqu’un ou qui sert à quelqu’un. Moi, je ne sers à rien et je ne sers personne. Je suis moi, c’est tout. Je suis ce que je suis. Je vis. C’est bien suffisant. En tout cas, moi, ça me suffit !
(…)
Rentré d’Amérique, je me fais des réflexions sur tout ce que j’ai vécu… Beaucoup… En particulier sur mes rapports avec Thérésa… Quand je l’ai rencontrée, il y a trois ans, je n’ai pas été enthousiasmé. J’ai même refusé longtemps de faire l’amour avec elle, par fidélité à Zida… J’ai fini quand même par aller avec elle dans une île, et nous avons vaguement fait l’amour, sans passion, à la papa… Elle était obsédée par ses problèmes sentimentaux et par d’autres et ne parlait que de ça… Le plaisir que nous avions était exactement corrélé à nos sentiments, c’est-à-dire médiocre… Et puis je lui ai proposé de venir dans mes groupes de formation, à notre rencontre annuelle, et là, ça a été la révélation… Je l’ai vue tellement impliquée, tellement vivante que j’en ai été bouleversé. Peu à peu, je suis devenu terriblement amoureux. Je me suis mis à l’aimer, très fort… C’est la première fois que je tombe amoureux d’une femme, en la voyant fonctionner en groupe. La plupart du temps, cette vision a plutôt pour effet de me refroidir… Je ne peux pas dire tout ce qui me séduit chez elle, tant il y a en a, depuis sa manière de bouger son corps, avec une liberté et une spontanéité incroyables, jusqu’à cette manière qu’elle a de se lancer dans l’action verbale et relationnelle… J’ai beaucoup souffert, car elle a aussi une très grande liberté avec les hommes et va jusqu’à l’amour, le sexe… Ma difficulté m’a entraîné jusqu’à la rupture, il y a quelques jours ; puis l’explication, le malentendu dissipé ont amené une rencontre amoureuse extraordinaire, dont je ne suis pas encore remis… Là encore, le plaisir ressenti est corrélé avec les sentiments… Il n’y a pas de mystère, pas de mécanique de la jouissance… On jouit exactement comme on sent…
(…)
Cette soirée où Nicole et Thierry fêtaient la nouvelle année chinoise du coq me plaisait a priori. On avait acheté des mets chinois, décoré la pièce à la chinoise et les gens qu’on avait invités étaient des amis. Tout était parfait. Et pourtant j’ai vécu, à nouveau ce soir-là, la même chose que je vis habituellement dans ce genre de situation, où le rire, la détente et la bonne humeur sont de rigueur, à savoir un énorme ennui, qui me donne envie de fuir et qui crée en moi un profond malaise. Ma première réaction face à cet état, en y pensant après ou au moment même, est de me justifier, de rationaliser mon mal-être, de systématiser. C’est tellement vide. Les gens ne s’expriment pas. Il ne se passe rien. On nage dans l’hypocrisie et le conformisme. Cet homme m’exaspère avec ses bouffonneries, etc. Et cependant les gens sont heureux et contents. Ils expriment leur satisfaction d’avoir reçu de la chaleur, de s’être retrouvés, d’avoir parlé ensemble…
Je ne peux faire fi de tels sentiments, dire que cela ne signifie rien. Non, cela est impossible. Il doit se passer quelque chose, puisque certains le ressentent… En y réfléchissant, je me dis que c’est peut-être cela, appliqué à un certain type d’activité, que j’appelle moi-même dépréciation et banalisation. C’est le processus que je dénonce avec force, qui consiste à négativiser tout un pan de la réalité, sous prétexte qu’il n’aurait aucun intérêt… Mais ce manque d’intérêt, qui se présente comme objectif, est en réalité parfaitement subjectif.
C’est difficile à analyser, mais il faut y voir probablement un manque d’attention ou de vigilance à l’égard de ce qu’il y a d’excitant là-dedans : le théâtre de certains, la manière passionnée de raconter des faits totalement ordinaires, les déformations apportées à ces faits, l’écoute apportée de la part des gens, etc.
En allant plus loin, je me demande pourquoi je suis comme cela et la seule réponse que je trouve est l’effroyable sérieux dans lequel vivait ma famille, qui n’excluait pas a priori le rire, mais qui ne le pratiquait pas. Quand une chose n’est pas intégrée, il est difficile d’y accéder… Je me souviens que j’étais jaloux des gens qui riaient et faisaient rire, comme s’ils avaient eu quelque chose qui me manquait, comme si j’étais un infirme par rapport à eux…
La meilleure défense contre la frustration que cela entraîne est évidemment la dénégation : cela n’a aucune valeur, cela est nul… Pour finir, je comprends maintenant pourquoi le théâtre a toujours été pour moi si difficile, je veux dire faire moi-même du théâtre, et pourquoi il a toujours été si thérapeutique. Je dis souvent que la psychanalyse que j’ai faite pendant quatre ans ne m’a pas beaucoup apporté, alors que des ateliers de théâtre que j’ai pu suivre ont été capitaux dans mon évolution… Dans des ateliers de clown, j’ai enfin pu faire rire…
(…)
A nouveau, je trouve, dans une pensée d’un penseur grec de l’antiquité, une idée qui me convient, transcrite en grec moderne. Il s’agit de Diogène (Diogénis), l’homme au tonneau. « Nous considérons, dit-il, la modération comme un grand bien, non pas à la vérité pour pouvoir nous restreindre à peu de choses, mais pour nous contenter de peu, quand nous ne possédons pas beaucoup ». C’est exactement ma théorie de la dépréciation. Je prétends que les obstacles installés par la société, le milieu et surtout les institutions à la réalisation de nos désirs les plus forts, les plus orientés vers le plaisir déterminent un état de frustration et de manque, une douleur, qui, à leur tour, nous poussent à déprécier, banaliser les désirs en question, pour échapper à la frustration. Les désirs hédoniques acquièrent une coloration neutre et antipathique, perdent leur intérêt. Ils s’éteignent. Le plus grave est la représentation sociale qui en résulte. La sexualité est vue comme sale, le jeu comme dérisoire, le loisir comme futile, l’étude comme ennuyeuse, la parole comme vide, la passion comme destructrice, etc. Les forces qui en nous sont motrices et facteurs de progrès, étant dévalorisées et niées, perdent leur pouvoir. Nous sommes plongés dans la stagnation, l’ennui et la tristesse…
Mais le pire n’est pas là. Il est dans les conséquences pratiques, j’allais dire historiques, de cet état de choses. Les aspirations et conduites hédoniques jouent un rôle central pour nous permettre d’échapper à l’angoisse en général, et spécialement à l’angoisse face aux nuisances, aux contrariétés et aux inquiétudes quotidiennes. Si nous sommes privés de leur secours et de ce que j’appelle leur irradiation, les réalités difficiles auxquelles nous sommes confrontés prennent une allure monstrueuse, deviennent de véritables montagnes, engendrent la terreur et nous nous ne pouvons nous défendre contre elles qu’en mettant en place ce que j’ai appelé autrefois des « super-défenses », c’est-à-dire des constructions réelles ou imaginaires censées être inexpugnables, de véritables forteresses invincibles et toute puissantes. Dès lors, nous ne vivons plus que dans et par ces forteresses, qui s’appellent la religion, l’Etat, la famille, le travail, le devoir, les croyances diverses etc. La réalité se chosifie, acquiert une texture minérale et dure, implacable. Seuls les faits sont pris en considération et les idées, les sentiments, les émotions sont déconsidérés, vus comme inutiles, gratuits et irréels…
J’ai essayé dans ce livre que j’ai publié en 1999, intitulé L’aventure humaine, de revoir l’histoire de l’humanité à la lumière de ces idées, comme un gigantesque affrontement entre les forces hédoniques et les forces sécuritaires. Je le dis sans prétention : ça colle, c’est explicatif…
(…)
Nicole a chez elle sa petite fille, qui a douze ans. C’est une fillette éveillée, charmante, sympathique… Je m’intéresse à ses intérêts. Tout chez elle est dirigé vers l’expression : scénique, picturale, les vêtements, le look, le chant, Star Academy, etc. Elle est imprégnée de culture américaine, écrit les trois quarts du temps en anglais, a une sensibilité de type américain, regarde passionnément la télévision, lit beaucoup…
Je me rappelle ce que j’étais à douze ans… un petit zombie. Je ne me souviens pas avoir existé à cet âge, alors que certainement j’existais. Je me heurtais aux murs physiquement, regardais de loin avec beaucoup d’ironie le curé qui nous enseignait, qui avait sur la tête une barrette ridicule, voyais mes parents mais ne les remarquais pas… Ce que j’avais en commun avec la petite fille, c’est la coupure avec l’environnement. On sent qu’elle a son monde à elle, dans laquelle personne ne pénètre, sauf peut-être ses copines. Tous les efforts que sa grand-mère fait pour y parvenir sont vains, malgré son attitude ouverte. Moi aussi j’étais parfaitement fermé, un monde clos…
Il est hallucinant qu’on enseigne à des enfants de cet âge je ne sais quelle discipline intellectuelle, dont ils n’ont rien à faire, alors qu’ils s’immergent littéralement dans une culture à eux – culture du spectacle, de l’expression, du look – qui est largement aussi intéressante. C’est une des pires aberrations de notre société, un véritable scandale… Le résultat est une coupure radicale avec le milieu, qui ne peut même pas être aboli par des efforts sérieux de ce milieu. Le phénomène de mépris joue à plein : les adultes sont ainsi et c’est irréversible. Ils sont rayés de la carte, nuls et non avenus. Ils peuvent faire ce qu’ils veulent, ça ne sert à rien… Dès l’instant où on n’a pas l’expérience d’un partenariat valable, il est presque impossible d’accueillir un partenaire potentiel qui se présente dans les meilleures conditions possibles. Dès l’instant où on a une expérience malheureuse, on se ferme même aux possibilités d’expériences heureuses. On bascule dans le mépris. Ceci est pour moi maintenant une conviction….
(…)
Je ne crache pas souvent sur mon ordinateur, mais cela peut m’arriver, si je me penche trop en avant sur le clavier et que je laisse tomber, par mégarde, une goutte de salive… Cet événement fut cause, hier, de la disparition de la lettre J du clavier en question, probablement parce que la connexion électrique ne se faisait plus pour cette lettre, qui avait été mouillée… J’eus beau souffler sur la lettre, utiliser un séchoir, la lettre ne réapparaissait pas… Cela déclencha chez moi une espèce de désespoir, de véritable désespoir… Comme si la terre s’était ouverte… Je n’allais plus pouvoir écrire… J’envisageais le pire, par exemple de renvoyer au vendeur l’ordinateur, qui était encore sous garantie, sans dire que j’avais craché dessus… Heureusement, après quelques essais infructueux, le fameux J réapparut brusquement, ce qui me procura un soulagement indicible… Je mesure, à partir de cet événement, ma dépendance à l’égard de cet appareil diabolique, véritable merveille qui relève de la magie, qui offre des possibilités qu’on ne pouvait même pas imaginer il y a trente ans…C’est ce que les économistes appellent la valeur d’usage, qui est ici considérable, et qui ne correspond pas nécessairement avec la valeur d’échange… Ne serait-ce pas une caractéristique de notre société, de nous offrir des objets présentant des avantages considérables, devenus tellement ordinaires et répandus qu’ils n’ont plus aucune valeur d’échange : l’eau courante, l’électricité, le tout-à-l’égout, la réfrigération, etc ? Imaginez que ces dispositifs disparaissent et voyez la panique. Notre société, en ceci, est profondément différente de celles qui l’ont précédée…
(…)
J’ai de longues conversations avec Thérésa., au téléphone. Ce n’est pas facile d’entretenir des liens à 5000 km de distance… Thérésa est une femme extrêmement réfléchie, responsable, qui voudrait se sortir de l’espèce de rigidité que cela engendre. Elle me dit qu’elle a été confortée dans son besoin de réfléchir par des lectures du Dalaï- Lama, qui préconise de mesurer la portée de ses actes, d’agir avec circonspection, position traditionnelle et paternaliste s’il en est. Elle me demande ce que j’en pense. Je lui dis que pour moi, c’est le contraire. La vie m’a appris à faire le contraire et je n’agis plus autrement. Je pense qu’il est impossible de mesurer toutes les conséquences de ses actes, qui sont innombrables et de toute façon imprévisibles. Le mieux, si l’on veut agir, et profiter des bienfaits de l’action, est de se laisser aller à sa spontanéité et de viser seulement le plaisir qu’on va retirer, à court terme ou à long terme. On est alors en accord avec soi-même et en accord avec le mouvement du monde, plein d’imprévus et de nouveautés…
J’ai agi ainsi, quand, par exemple, en 1969, j’ai quitté le Centre National de Pédagogie Spéciale (CNPS) de Beaumont-sur-Oise, où j’étais fort bien, à cause d’un conflit qui rendait pour moi impossible la collaboration avec les autres professeurs. Je n’avais aucune solution de repli, aucune, sauf le congé de maladie, qui n’était pas une solution, que j’ai été obligé d’adopter. Par bonheur, l’Université de Vincennes se créait alors et j’ai pu y être intégré, ce que je n’aurais jamais obtenu, si j’étais resté au CNPS. Vincennes a été une expérience fantastique… J’ai vécu cela souvent dans ma vie…
On me dira : ne peut-on agir que par plaisir ? Le plaisir est-il le seul moteur dans la vie ? Evidemment non : le danger existe et aussi les protections contre le danger. Il faut se protéger, et même le faire bien, efficacement. Cela aussi est ordonné au plaisir : il n’y a plus de possibilité d’agir si on est malade ou handicapé… Le seul problème est de faire en sorte que cette nécessité de se protéger n’arrête pas le mouvement vers le plaisir. Cela exige des choix, de courir des risques. Il faut savoir ce qui est le plus important, du plaisir ou de la protection de soi-même. La protection doit être là quand elle devient l’exigence première et incontournable. Elle devient par contre parfaitement nuisible, sitôt qu’elle ne s’impose plus comme une urgence, n’est plus qu’un possible parmi d’autres, une éventualité, une bonne solution. Il faut alors la repousser avec force, comme une atteinte à la vie… J’explique cela à Thérésa, qui agrée, qui est d’accord, et qui me remercie de l’éclairer…
(…)
Quand l’entretien avec Pierre était déjà fini, celui-ci me posa une question impromptue, qui était celle-ci : est ce que tu penses que des gens qui s’aiment doivent vivre en couple ? Il entendait par là : vivre en ménage, ou encore ensemble, car on confond souvent le couple avec la cohabitation… Question intéressante, à laquelle je répondis sans hésiter : pour ma part, j’ai décidé depuis au moins vingt ans de ne plus jamais cohabiter avec une femme que j’aime. Pierre, étonné, me demande pourquoi, je lui réponds qu’à mon avis la cohabitation gâche l’amour, à la limite le supprime, et que si on veut sauvegarder un amour, mieux vaut vivre séparément, quitte à se voir souvent, peut-être même tous les jours, mais sans cohabiter…
J’ai vécu en cohabitation avec des femmes quatre fois dans ma vie : avec ma première femme, Simone, avec laquelle j’ai eu deux filles et cela durant 12 ans ; avec une américaine, Jane, durant quatre ans ; avec une australienne, durant quatre ans aussi; et enfin avec Evelyne, d’origine juive-polonaise, durant quatre ans. Dans les années 80, c’était fini, ma décision de vivre seul était prise et définitive .Je dois m’en féliciter… Mes vrais grands amours, je les ai eus après, en particulier avec Nicole, avec laquelle j’ai une relation qui dure depuis 25 ans. Cela ne m’a pas empêché d’avoir des relations ailleurs, en particulier avec des femmes grecques. Nicole aussi avait des relations extérieures…
Qu’est ce qui justifie une telle position, qui, à mon avis, a une valeur générale, quand on voit le grand nombre de couples mariés ou cohabitant, chez qui la sexualité disparaît avec une grande rapidité ?… Il y a beaucoup d’éléments difficiles à analyser. Un d’entre eux est le fait que les manies et habitudes qu’on a, qui paraissent sans importance, sont en fait très importantes. Or, le partenaire les partage rarement. Il faut donc que j’y renonce ou qu’il renonce aux siennes. Dans les deux cas, cela n’est pas un facteur de bien-être. Un autre élément, à l’opposé, est le fait qu’on perçoit assez vite, dans un couple, un défaut majeur de l’autre, qui s’intègre fortement à sa personnalité et auquel il n’est pas prêt de renoncer. Il est presque impossible d’aborder les problèmes que cela pose, étant donné le caractère explosif d’une telle interrogation. Un autre élément encore est le phénomène d’usure, qui joue beaucoup sur la sexualité. Il est difficile de se reprendre, d’essayer un autre mode de fonctionnement, quand on est soumis à la pression journalière de l’autre. On pense plutôt à se protéger….. Autrement dit, il est difficile de gérer les crises et les conflits quand on est trop proche de l’autre. Or, la vie en commun est génératrice de crises et de conflits… J’appelle cela être imbriqué, et j’oppose l’implication à l’imbrication. Il faut être impliqué et non pas imbriqué. L’implication est le moteur de l’amour, ce qui le fait vivre, et l’imbrication est ce qui le fait mourir.
(…)
Le maximum de bonheur ne se rencontre pas dans les activités mêmes, mais dans la pensée de celles-ci, ou encore dans la pensée de personnes ou d’objets liés à ces activités. Le bonheur réside finalement dans le fait d’être habité, intérieurement, par des personnes, des objets ou des actions. Où l’on voit très bien la nature mentale de l’être humain, son caractère psychique…. Et il faut dire immédiatement que le maximum de malheur est aussi dans la pensée, spécialement quand on est hanté par des images, pensées, souvenirs qui ne vous quittent plus, qui s’implantent en vous comme des poisons …. Pour aller plus loin, il faudrait que je me concentre sur une de ces pensées heureuses….
(…)
Aujourd’hui, 3 Mars 2005, jour solennel : le Parlement vient de voter la loi Fillon sur l’école, Il s’agit du mille et unième réaménagement de l’école, présenté comme la réforme de Jules Ferry, comme une trouvaille géniale et révolutionnaire. Les écoliers, à qui on donne cet os à ronger, s’opposent à cette loi, qui établit ce qu’ils réclamaient autrefois, ce qu’on ne manque pas de remarquer avec une certaine ironie… Loin de moi de vouloir ironiser sur les écoliers, ces victimes d’un système absurde. Ce qui me frappe est leur prosaïsme, leur pragmatisme : le fait qu’ils ne s’intéressent apparemment qu’à leurs chères études, qui va leur permette d’obtenir des bons diplômes, qui leur seront utiles dans la vie… A la vérité, ce n’est pas du pragmatisme, mais de la sinistrose, qui en est la forme extrême, désespérée. Il s’agit d’un collage à l’utilitaire, au profit, qui relève plus de l’angoisse que du calcul…
Mais, dira-t-on, n’est ce pas normal que les écoliers soient angoissés, face à cette absence d’avenir qu’on n’arrête pas de dénoncer ? Non, ce n’est pas normal… L’école est faite précisément, ou pourrait être faite, pour permettre de sortir de la hantise du lendemain, en s’adonnant à autre chose, à des choses positives et heureuses, qui non seulement font oublier les soucis du futur mais initient un autre futur, un autre possible… Je pense en effet, comme on le sait, que le plaisir est le seul remède, la seul antidote à la peur et à l’inquiétude. Seul il est capable de casser l’engrenage fatal, qui est, je le rappelle : barrage au plaisir = frustration = dépréciation = terreur. Je ne reviendrai jamais assez sur cette équation fondamentale…
Je n’ai peut-être pas assez insisté sur son dernier élément : le fait que la dépréciation entraîne la terreur. On n’en a pas de meilleure preuve que, justement, ce qui arrive à l’école. Dès l’instant où des gens considèrent comme dérisoires, ou comme ennuyeux, ou comme fatigants des processus fondamentaux de la vie psychologique, tels que le savoir, l’apprentissage, l’étude ou toutes les choses dans ce genre, ils ne peuvent faire autrement que d’être terrorisés par les objectifs qu’ils doivent atteindre – le travail, la profession, le gagne-pain, l’occupation – dont la réalisation passe par ces processus. Un enfant à qui on serine, toute son enfance, surtout dans les milieux modestes, que son succès dans la vie dépend des diplômes et des notes obtenus, ne peut qu’être terrorisé par le travail que cela demande, qui ne signifie, en aucune manière, du plaisir pour lui. Celui, par contre, qui fait, par plaisir, ces activités, tellement utiles et tellement nécessaires, ne s’aperçoit même pas qu’il est en train d’assurer son avenir…
Cela me fait penser à ces femmes, de plus en plus nombreuses, qui, croyant avoir fait le tour de toutes les ressources de la liberté des mœurs, disent que maintenant elles cherchent le sérieux et seulement le sérieux, un homme fidèle et responsable, capable d’assumer une famille et de les aimer pour toujours… Elles font exactement le contraire de ce qu’il faut pour trouver ce qu’elles cherchent. L’anxiété que forcément elles déploient dans cette quête ne peut être qu’un obstacle à l’amour, condition première de cette réalisation. Il y a une fable de La Fontaine, qui s’appelle La fille, qui fait suite au Héron, qui dit cela parfaitement…
(…)
En France actuellement (Mars 2005), on ne parle que du vote concernant la future constitution européenne. Impossible même de savoir de quoi il s’agit. Je n’ai aucune idée. Je ne peux que me faire des réflexions générales, tirées de ma pratique d’historien. Je me dis que l’Europe unie est évidemment une bonne chose, car il vaut mieux collaborer que de se faire la guerre. Tous les Etats qui se sont constitués en Fédération, comme beaucoup d’Etats du continent américain, ont cessé, à partir de ce moment, de se faire la guerre. Mais la Fédération résultait elle-même, la plupart du temps, d’une guerre, comme la guerre de Sécession aux Etats-Unis ou les guerres qui ont conduit à la réunification de l’Allemagne ou de l’Italie. Ici, dans le cas présent, il n’y a pas de guerre…
Etonnant comme la politique fonctionne dans le négatif, comme il est difficile de savoir ce qui est bon pour un pays, alors qu’on prend parti avec violence dans un conflit. C’est un des signes pour moi du fait que nous ne pensons pas pour l’homme, son bonheur et son épanouissement, mais en fonction d’intérêts qui nous prennent à la gorge, même parfois d’intérêts idéologiques. Par exemple, certains hommes de gauche disent qu’il ne faut pas voter pour le projet présenté, car il ne prévoit quasiment rien pour le social. Mais est-il bon que tous les Etats d’une union aient la même politique sociale, qui serait, dans ce cas, imposée d’en haut, comme dans l’ex-URSS ? Cette question, ces gens ne se la posent pas, obnubilés qu’ils sont par le primat du social, ce qui est de l’idéologie, et la plus discutable. Le social est en soi une bonne chose, sauf s’il rend aveugle à l’homme. L’humanisme n’est pas un thème de propagande, c’est un vrai sujet de réflexion et de recherche, le plus important actuellement…
(…)
Depuis quelques années, je me suis mis à lire et à étudier les journaux d’adolescents. L’idée m’en est venue en lisant le journal d’Anna Franck, qui est d’un grand intérêt, non pas seulement à cause de la situation dramatique où elle se trouve, mais comme document psychologique, témoignage de la mentalité adolescente… J’ai connu un organisme qui collectionne les journaux d’adolescents et je l’ai contacté, ce qui m’a permis de consulter un certain nombre de ces journaux… Parmi eux, le journal de Suzanne S. est d’un intérêt tout particulier. Il se poursuit sans arrêt de l’âge de 13 ans à l’âge de 20 ans et nous fait connaître une personnalité extraordinaire par son intensité, sa perspicacité et ses capacités amoureuses… Le problème que je me pose depuis longtemps est de savoir pourquoi un jeune se développe particulièrement vite et bien sur le plan des relations à autrui, pour ne prendre que cet aspect-là. Mon idée, parfaitement non-conformiste, est que cette capacité est initiée par un terrain familial favorable et que celui-ci devient favorable quand les parents s’expriment sur eux-mêmes. Alors ils sont démystifiés, perdent leur prestige et, s’ils se plaignent, ils peuvent même être dévalorisés aux yeux du jeune. Peu importe, le jeune prend contact avec la subjectivité parentale, ce qui l’ouvre aux autres, vers qui il peut se diriger ensuite d’une manière plus positive qu’avec les parents… Cela est largement confirmé par le journal de Suzanne S. Alors qu’elle a 18 ans, elle écrit : « Papa n’arrête pas de crier, de rouspéter, de se plaindre, de faire le ridicule avec sa stupide maniaquerie ; je me demande souvent comment maman fait pour le supporter ; il est vrai qu’elle est souvent aussi pénible que lui ! Quant à moi, je ne le supporte plus ; j’ai envie de l’insulter perpétuellement, je ne peux plus supporter son humeur, ses cris, ses plaintes et tout le reste, j’ai les nerfs à nu, je crois que je vais craquer ; quand je l’entends, j’ai presque envie de hurler, que faut-il faire pour être sourde à sa voix détestée ? Jamais je n’arriverai à le supporter toute la durée de mes études ! Jamais ! Quand je pense que je suis condamnée à être ici pendant quelques années encore, je deviens folle ! Je ne suis contente que quand il est dans sa cave, ainsi je n’entends pas sa voix. Le voilà qui remonte, à peine dans la cuisine, il commence déjà à rouspéter, je sens que je suis à bout. Plus les semaines passent et moins il est facile pour moi de le supporter (…) Est-ce moi qui devient nerveuse au point de ne plus supporter ce que je subis depuis 18 ans ? » Pauvres parents, pourrait-on dire, qui présentent une face aussi misérable ! Mais une face misérable est une face humaine. Ce n’est pas la statue du commandeur. Et la fille, bien qu’elle en souffre, participe de cette humanité, qui l’ouvre au monde… J’ai l’idée que cela est structural.
J’avais remarqué, depuis longtemps, le nombre incroyable d’écrivains qui sont des orphelins. Et cela est confirmé par C. Thélot, qui, dans son livre L’origine des génies (2003), remarque que cette propension à être orphelins caractérise les écrivains, par opposition aux autres génies. Un orphelin est quelqu’un dont la mère, le plus souvent, souffrant de se sentir abandonnée ou isolée, se plaint et ainsi s’exprime, prenant son enfant à témoin. Celui-ci fait ainsi l’expérience subjective… Il a tout ce qu’il faut alors pour devenir un écrivain, quelqu’un qui, d’après Crébillon fils, « voit l’homme tel qu’il est ».
(…)
Un de mes clients en psychothérapie me livre une information qui confirme une idée que j’avais depuis longtemps mais sans preuve directe. Cette idée, c’est que le client ne se contente pas de parler, mais qu’il agit sur le thérapeute, qui s’en trouve modifié. Ceci est ce que le client recherche, même s’il ne le dit pas. Autrement dit, le client éprouve une satisfaction forte en voyant qu’il est écouté et que l’intérêt qu’il provoque est dû à la manière dont il délivre son message et dont il l’élabore. Il se donne en spectacle à lui-même indirectement. C’est pourquoi, il est si important qu’il voit le thérapeute, que celui-ci montre qu’il écoute et même réagisse positivement par des questions ou des remarques, comme le propose la NDI. J’appellerai volontiers ce retour sur le client de sa prestation : l’effet rétroactif… Il y a aussi un effet rétroactif éprouvé par le thérapeute, mais différent. Il consiste dans le fait que l’attitude d’écoute du thérapeute et ses réactions ciblées, du fait qu’elles sont attendues et voulues par le client, procurent un sentiment de satisfaction au thérapeute, confirment son efficacité…
Donc, ce client, homme empêtré dans de multiples relations amoureuses, me dit qu’au début, dans les premières années, il pensait que j’avais pitié de lui, que je le considérais comme un paysan mal dégrossi, puis il avait évolué, en voyant mes réactions. Il avait compris que j’étais proche de lui et peut-être que je partageais ses états d’âme. Cela l’avait encouragé à aller plus loin, comme un acteur est poussé par son public à s’engager d’avantage, à s’exprimer plus et mieux… Derrière tout ceci, il y a l’idée que l’intervention de l’autre, si elle est personnalisée, constitue un choc et une expérience pour celui qui en est l’objet. Peu importe qu’elle se situe à l’origine, comme dans le cas du client, ou qu’elle soit une réponse, comme dans le cas du thérapeute. De toute façon, elle est un événement. Cet événement est aussi important que l’appréhension mentale d’une donnée externe, dans l’activité intellectuelle, ou que la réalisation d’un projet moteur ou créateur dans l’activité sensible. C’est le matériau de base de la vie relationnelle…
(…)
Problème important de savoir ce qu’il faut dire pour aider quelqu’un. Pas nécessairement en thérapie, mais même dans la vie… J’expérimente cela ces jours-ci à travers Jacques, qui nous parle de ses problèmes avec sa copine, problèmes importants avec une copine qui l’envahit complètement, qui n’arrête pas de lui faire des scènes parce que soi-disant il ne l’aime pas assez, il ne lui dit pas assez qu’il l’aime, etc. Cela se traduit par des reproches violents, accompagnés d’ironie cinglante… Jacques nous demande ce qu’on en pense. Nous, spontanément, on attaque cette mégère, on dit à Jacques qu’elle est insupportable, qu’elle le persécute, qu’il doit la quitter, etc. Mais cela ne plaît pas tellement à Jacques, ne l’aide pas, car finalement il aime cette fille et il préférerait sans doute qu’on le plaigne, lui, mais sans l’attaquer, elle, ce qui parait contradictoire, presque impossible, mais c’est pourtant la réalité…
Cela se passe aussi à travers moi. Je parle à Nicole de mes problèmes avec Thérésa et je lui raconte ce qu’elle me fait subir. Ce n’est pas mince : rejet, humiliation, etc. Nicole se montre scandalisée par son attitude à elle, déclare que c’est odieux, que c’est un monstre, etc, ce que je comprends très bien. Pourtant, cela ne me plait pas et ne m’aide pas, car j’aime cette fille, et, malgré ses côtés odieux, je l’estime, car je connais d’autres côtés d’elle. Les paroles de Nicole me mettent mal à l’aise, en colère contre elle…
Cela me fait réfléchir. Ne peut-on rien faire d’autre pour aider quelqu’un que de rentrer empathiquement dans ses sentiments et de les lui renvoyer ? Non, je ne crois pas. Je remarque en effet qu’en discutant avec Nicole sur les raisons pour lesquelles Thérésa me réclame des lettres qu’elle m’a envoyées, les arguments de Nicole m’éclairent. Elle le fait, pense Nicole, non pas pour utiliser ces lettres contre moi mais pour que je ne les utilise pas contre elle. Cela paraît finalement clair.
On pourrait donc en conclure que les remarques objectives sur la situation aident la personne en difficulté, alors que les sentiments et réactions d’ordre affectif de la personne qui écoute ne l’aident pas. Cela est normal. Les sentiments et réactions de l’écoutant interfèrent avec les sentiments et réactions de l’émetteur, les contredisent et ne permettent pas à l’émetteur d’approfondir ses propres sentiments. Par contre un éclairage objectif peut l’aider à comprendre et lui fournir de nouvelles pistes. Cela semble justifier la méthode cognitiviste en psychothérapie. Oui, mais à condition que l’apport cognitif ne soit pas systématique, mais dépende totalement de la demande de la personne aidée. C’est le principe de la NDI.
(…)
Je suis dans ma voiture, revenant de la campagne, et j’écoute la radio : France-culture… Chouette, une discussion sur le problème de l’autorité… Je vais l’écouter… Malheureusement, animée par celui que j’appelle « l’inévitable Fienkelkraut ». J’appelle ainsi tous ceux qui, se présentant comme des progressistes, sont en réalité des conservateurs, voire des réactionnaires, de la plus belle eau : les plus redoutables… Une certaine madame Revault-d’Allones parle de son dernier livre sur L’autorité.
Je suis surpris d’apprendre que, d’après cette dame, l’autorité n’a rien à voir avec le Pouvoir ou la contrainte. Cette notion connote seulement une influence de type dissymétrique où un des éléments a le pas sur l’autre, etc… Je rugis : une fois de plus, dans cette époque où nous sommes, on cherche à nous faire avaler la pilule la plus méchante avec des sourires et des cajoleries. Ne croyez surtout pas, braves gens, que l’autorité, qui écrase quotidiennement des milliards de gens, soit dangereuse ou mauvaise ! Non, c’est une excellente potion, utile à tous et spécialement aux petits enfants…
Rentré chez moi, je saute sur le Littrè, qui est le dictionnaire le plus fiable que je connaisse et je regarde l’article « autorité ». Il y a six sens indiqués et les deux premiers, de loin les plus importants et qui prennent le plus de place, expriment le « pouvoir de se faire obéir ». Il y a beaucoup de références littéraires pour appuyer cela. Dans la comparaison, à la fin, avec le mot « pouvoir », les auteurs indiquent « ces deux mots sont très voisins l’un de l’autre ».
Ma colère passée, je m’interroge : pourquoi vouloir, à tout prix, altérer le sens d’un mot, alors que tout le monde connaît, depuis longtemps, le sens de ce mot ? Cela fait partie, à mon sens, des stratégies lénifiantes, c’est-à-dire qui s’insèrent dans les discours que les gens se tiennent à eux-mêmes quand ils veulent s’auto-persuader… Ce qui se passe avec l’autorité est le contraire de ce qui se passe avec la sexualité. Contrairement à ce que dit, je ne sais pourquoi, Michel Foucault, les termes et expressions à connotation sexuelle, sont interdites et réprimées. Cela veut dire qu’on les emploie peu ou difficilement, même si les termes à allure scientifique sont plus répandus…
L’autorité, par contre, est valorisée. Cependant, il faut pouvoir l’utiliser sans réticence, ce qui n’est pas si facile, étant donné la critique acerbe que cette notion a subie dans les années 1970. Il faut donc la réhabiliter, la dépoussiérer. Quoi de mieux, pour y arriver, que de mettre en avant un de ses sens dérivés, qui n’a pas les connotations négatives du sens principal et auquel on va penser, quand on devra signifier celui-ci ?
Il est important de pouvoir penser une chose, en se la représentant telle qu’elle est, sans fard et sans détour. C’est un véritable processus thérapeutique, dont le procédé utilisé à la radio est l’opposé.
(…)
Quel malheur que ces deux êtres se déchirent à ce point ! Eux qui ont créé, en Normandie, un lieu magnifique, où ils accueillent leurs amis et d’autres avec une générosité exceptionnelle, sont comme deux bêtes fauves quand ils se disputent. Elle, généralement, s’en prend à lui qu’elle accuse de trop s’affirmer, de prendre toute la place, de ne pas l’écouter et lui ne peut supporter ses cris et sa violence. Constamment, il se demande : vais-je la quitter ? Mais il ne la quitte pas, car il devrait, du même coup, abandonner tout ce qui fait sa vie et son bonheur. Cela semble sans solution, irrécupérable. Je les vois mal vieillissant ensemble, malgré le fait qu’ils ne peuvent se séparer.
Leur situation n’est pas exceptionnelle. On pourrait dire qu’elle est plus ou moins la règle. La haine s’empare de la plupart des couples, envahit leur vie. A quoi attribuer un tel destin ?
Il me semble que la cause de cela est à chercher du côté de cette idée qui s’est emparée de nos contemporains depuis un siècle, à savoir que le couple ne peut être fondé que sur l’amour. Excellente idée, idée géniale, qui, malheureusement, comporte une contradiction intrinsèque… Il faut réfléchir à ce qu’est l’amour. Ce n’est pas une réalité stable et intangible, comme la santé ou la beauté, mais le résultat d’une conquête permanente. L’amour est fondé sur l’attrait. Il faut attirer l’autre et que l’autre vous attire. Cela implique qu’on ne montre pas, qu’on cache ou qu’on masque les côtés les plus désagréables de soi-même.
Or, ces côtés, on les étale, littéralement, quand on vit avec quelqu’un. Au début, on évite de les manifester, à la fois parce qu’on est centré sur l’autre et qu’on veut lui plaire. Puis, peu à peu, on se relâche, on est de plus en plus soi-même et on n’hésite plus à montrer ce qu’on est. La vérité intoxique la vie. Les côtés négatifs qu’on a tous éclatent au grand jour.
Il y a alors deux possibilités. Ou bien, l’un des deux se plie à l’autre, accepte l’inacceptable, entretenant en lui une mentalité de sacrifié et de victime, qui le pousse à la résignation et, quelque part, le valorise. Ou bien, aucun des deux ne cède, car les deux veulent pouvoir être eux-mêmes et se réaliser. C’est la guerre.
Il y a encore une troisième solution, issue des progrès qui se sont opérés dans les mœurs depuis quelques décennies. On divorce, ce qui se fait de plus en plus en France et ailleurs. En Amérique, on multiplie les couples successifs. Mais on ne fait que recommencer. Le second couple ressemble étrangement au premier et le troisième au deuxième. C’est normal, si on ne change pas radicalement la formule de base, qui consiste à vouloir s’aimer en partageant tout. On ne peut aimer le désagréable et le pire, quoi qu’on en dise et quoi que dise le prêtre qui vous marie. Cela est contre la logique affective.
Il faut donc non seulement faire l’apologie de l’amour mais découvrir quelle est la formule institutionnelle qui lui convient. Le ménage est, à mon avis, la pire des choses, car il oblige à subir les merdes de l’autre. Toute communauté de vie aboutit à ce résultat, y compris la communauté monastique, qui a la franchise de reconnaître qu’elle veut cela pour des raisons ascétiques. Même la famille, surtout la famille, est fondée sur ce modèle, et c’est pourquoi la famille est la force rétrograde par excellence, le frein le plus formidable au progrès de l’humanité. Il faudrait trouver des formules communautaires positives et enrichissantes, qui utilisent le principe familial avec réserve et modération, par exemple pour les moments où l’entraide et la cohabitation sont nécessaires…
(…)
Je parle avec Nicole dans la voiture qui nous ramène du centre de la France et j’aborde à nouveau l’éternel problèmes de savoir pourquoi, à dix-neuf ans, je suis rentré chez les dominicains, ce qui m’apparaît maintenant comme une absurdité totale… Ah oui, je sais pourquoi je reviens à cela… Je me suis dit à la suite de mes réflexions actuelles sur les processus éducatifs que l’éducation que j’avais eue, ou plutôt la non éducation, m’avait amené à faire n’importe quoi… Rentrer chez les religieux était, pour moi, faire n’importe quoi…
Mais faire n’importe quoi, c’est quand même faire quelque chose… je répète à Nicole que je n’arrive pas à percevoir les motivations qui m’ont poussé… Pourtant, il y avait des motivations… Mystère de ces motivations, qui nous sont cachées même à nous-mêmes, ce qui explique que la psychanalyse ait pu imaginer qu’on puisse les retrouver (« le contenu latent ») grâce à une méthode associative, qui est un leurre…
Je passe à nouveau en revue les motivations qui auraient pu me pousser à cela : sentiments religieux, peur de la sexualité, désir de protéger ma vie intellectuelle, etc. Rien ne colle. Pourtant quelque chose de nouveau apparaît, qui est le fait qu’à aucun moment je ne me suis demandé si j’allais pouvoir supporter la dureté de cette vie, son côté ascétique. Je ne me souviens pas m’être posé une seule fois la question. Je me souviens seulement avoir vu un dominicain prêcher et m’être dit que j’aimerais être dans cette position de prestige. Prestige cher payé… Mais tout prestige n’est-il pas cher payé ? Le prestige cher payé, cela s’appelle l’héroïsme… Est ce que je ne réagissais pas, au fond, comme ces jeunes musulmans, qui, actuellement, se transforment en kamikaze par centaines au Moyen-Orient… Eux aussi cherchent le prestige…
Phénomène de jeunesse, c’est bien connu… Mais pourquoi la jeunesse est-elle comme cela ? Probablement parce qu’elle est proche de l’enfance, de cette période où nous n’avons pas encore étouffé toutes nos forces de vie… Effectivement, j’avais une vocation à l’héroïsme. Plus jeune, j’avais rêvé de faire la conquête du pôle sud ou nord, comme Amundsen, Nansen, Perry, etc d’explorer l’Afrique comme Brazza et bien d’autres choses aussi folles…Je choisissais la vie religieuse parce que c’était la chose la plus proche des idéaux de ma famille. J’aurais pu choisir le trotskysme ou le maoïsme, si j’avais appartenu à la génération suivante… Peu importe la forme d’héroïsme, pourvu qu’on puisse déployer courage, hardiesse et détermination. C’est cela qui est important, cela qui nous valorise et nous met en transe… Je n’admire pas actuellement les valeurs que cela représente… Tant pis ou tant mieux !
(…)
La petite fille de Nicole, 14 ans, passe quelques jours chez sa grand-mère, qu’elle aime beaucoup. Elle fait, chez Nicole, la même chose que ce qu’elle ferait chez elle, à savoir regarder la Télé, jouer avec l’ordinateur, lire des journaux de jeunes. A propos de ceux-ci, elle est particulièrement enthousiaste d’un magazine pour jeunes qui s’appelle « closer », que je consulte et sur lequel je fais une espèce de recherche. Il y a dans ce journal deux fois plus d’images de femmes que d’hommes. La majorité des femmes sont seules alors que les hommes sont en couple et les femmes sourient beaucoup plus que les hommes. C’est évidemment orienté, dans le sens de l’autonomie de la femme, avec une dévalorisation des hommes…
On a envie de crier au scandale et de dénoncer une pression sur les enfants… Oui, mais les enfants y accrochent, c’est évident, et je fais l’hypothèse que l’essentiel, pour se développer, c’est d’accrocher à quelque chose. C’est de toute façon mieux que de vomir l’école et d’y passer un temps énorme, avec un impact négatif. C’est ce qui se passe pour cette petite fille. On ne peut pas imaginer à quel point elle déteste les mathématiques. Son grand père, féru de mathématiques, en fait une maladie…
Toute influence est de toute façon orientée et nous vivons des influences que nous recevons. Nous nous construisons avec elles. Le pire, ce sont les influences qui nous détournent de la réalité, comme celles qui regardent les mathématiques. Dès l’instant où une influence révèle quelque chose, un phénomène donné, une réalité, j’estime qu’elle est bonne. Je l’ai constaté avec cette petite fille. Je lui ai fait un entretien il y a quelques années, à une époque où elle regardait avec passion « Star Academy ». Elle m’a dit qu’elle voulait devenir chanteuse, être une star. Quoi de mieux ? Elle avait un projet de vie. Ce n’était pas l’école qui le lui donnait. On peut construire quelque chose là-dessus.